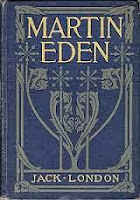Etonnant de se plonger dans les statistiques de visites du blog. Ci-dessous le palmarès des 10 meilleurs pays de provenance des visiteurs.
France : 51 463
| |
États-Unis : 4615
| |
Russie : 2189
| |
Algérie : 2020
| |
Belgique : 1 994
| |
Allemagne : 1 265
| |
Suisse : 1 220
| |
Tunisie : 1 130
| |
Canada : 766
| |
Lettonie : 579
|
Ici on tente de s'exercer à écrire sur l'architecture et les livres (pour l'essentiel). Ça nous arrive aussi de parler d'art et on a quelques humeurs. On poste quelques photos ; celles qu'on aime et des paréidolies. Et c'est évidemment un blog qui rend hommage à l'immense poète et chanteur Léonard Cohen.
mardi 29 octobre 2013
Statistiques
lundi 28 octobre 2013
Le nazi et le barbier
"Je me présente : Max Schulz, fils illégitime mais Aryen pure souche (...). Itzig Finkelstein habitait la maison d'à côté. Il avait mon âge ou, pour être plus précis (...), Itzig Finkelstein a vu le jour exactement deux minutes et vingt deux secondes après que la sage-femme Marguerite Grosbide m'eut délivré d'un coup sec et vigoureux de l'obscur ventre de ma mère... Si tant est qu'on puisse parler de ma vie comme d'une délivrance..."
Ainsi commence "Le nazi et le barbier" roman tour à tour délirant et terrible d'Edgar Hilsenrath, publié avec succès en 1972 aux Etats-Unis, qui fit scandale en Allemagne lors de sa publication en 1977, et du encore attendre 2010 pour être traduit en français !
Les 481 pages (qui se lisent avec compulsion) correspondent à un tour de force incroyable qui nous rendrait presque sympathique Itzig Finkelstein alias le génocidaire Max Schulz. Vous comprenez que c'est un livre sur une schizophrénie impossible et pourtant assumée, qui entraine le lecteur de Wieshalle (Silésie) jusqu'à la Terre Promise, en passant par les camps de la mort et les bas-fonds du Berlin de l'aprés-guerre, gangrené par le marché noir. On y parle savamment de barbier (un métier quasiment disparu) et avec une objectivité noire de nazi (un métier qui tend à réapparaître).

 C'est un livre qui parle du racisme imbécile, de la peur, la haine, l'abjection, la folie banale, la perversité, la bassesse la plus terrible, la force de la médiocrité, la Shoah, le nazisme, tout ça sans pathos, mais plutôt sous l'angle de la dérision et de l'humour (noir et grinçant bien entendu). On est loin des "Bienveillantes", mais la démonstration est certainement encore plus puissante. Itzig Finkelstein alias le génocidaire Max Schulz est un tantinet porté sur la gaudriole, ce qui nous vaut quelques scènes truculentes de copulations débridées (Houellebecq s'en est-il inspiré dans "les Particules élémentaires" ?). C'est un livre de la désespérance mais qui ne vous laisse pas désespéré ; un livre sur l'absurde (Dieu est ultimement piégé). Edgar Hilsérath est un extraordinaire observateur, un "limier" de la condition humaine. Le livre est servi par un style qui alterne le questionnement bouillonnant (vis-à-vis du lecteur) et des phrases d'une richesse poétique formidable. Dois-je avouer qu'il s'agit pour moi d'un chef d'oeuvre ?
C'est un livre qui parle du racisme imbécile, de la peur, la haine, l'abjection, la folie banale, la perversité, la bassesse la plus terrible, la force de la médiocrité, la Shoah, le nazisme, tout ça sans pathos, mais plutôt sous l'angle de la dérision et de l'humour (noir et grinçant bien entendu). On est loin des "Bienveillantes", mais la démonstration est certainement encore plus puissante. Itzig Finkelstein alias le génocidaire Max Schulz est un tantinet porté sur la gaudriole, ce qui nous vaut quelques scènes truculentes de copulations débridées (Houellebecq s'en est-il inspiré dans "les Particules élémentaires" ?). C'est un livre de la désespérance mais qui ne vous laisse pas désespéré ; un livre sur l'absurde (Dieu est ultimement piégé). Edgar Hilsérath est un extraordinaire observateur, un "limier" de la condition humaine. Le livre est servi par un style qui alterne le questionnement bouillonnant (vis-à-vis du lecteur) et des phrases d'une richesse poétique formidable. Dois-je avouer qu'il s'agit pour moi d'un chef d'oeuvre ?
Merci à Etienne V. qui se reconnaitra s'il s'égare jusqu'ici, et à qui je dois cette très belle et très sombre découverte.
Nota : la pièce de théâtre se joue actuellement au Petit Hébertot (à vos places !)
mardi 22 octobre 2013
A méditer
"Le principal ennemi de la créativité est le bon sens."
Pablo Picasso
NB : Merci à Bruno S. (qui se reconnaitra s'il parvient jusqu'ici)
Pablo Picasso
NB : Merci à Bruno S. (qui se reconnaitra s'il parvient jusqu'ici)
Martin Eden
Quand Jack London écrit "Martin Eden" il n'a que 33 ans et le récit sonne pourtant comme une autobiographie ; de celle qu'un écrivain peut écrire au soir de sa vie. 7 ans plus tard, le 22 novembre 1916, Jack London qui était atteint de plusieurs maladies (dysenterie, urémie, mais surtout alcoolisme) meurt d'avoir trop vécu. Suicide ? Empoisonnement par négligence du fait d'une automédication ? Le doute entretient encore davantage le "mystère" Jack London, écrivain de la race des Rimbaud, Hemingway, ou autres Kerouac ; celle des "perdants magnifiques" ?
Personnage de roman lui-même (enfance difficile, génie autodidacte, bagarreur, marin, ouvrier, chercheur d'or, photographe*, écrivain à succès, etc.), il met en scène dans "Martin Eden" son double, d'abord un jeune homme un peu rustre mais qui ne manque pas de sensibilité, fasciné par la classe des gens instruits, submergé par une passion pour Ruth, une très belle jeune femme de cette bourgeoisie à laquelle il croit pouvoir accéder par l'apprentissage du savoir. Mais tout se révèle en définitive faux et illusoire, sauf certaines amitiés construites sur le partage de l'adversité ou d'une certaine notion de la beauté. L'étude compulsive des livres et son sens aigu de l'observation font rapidement de Martin Eden un révolté ; en particulier contre une société confite dans ses "valeurs établies", conduite par des sots dont le pouvoir ne repose que sur des diplômes obtenus sans intelligence, la flatterie ou une situation sociale privilégiée. Il se débat jusqu'à l'épuisement car personne (sauf Brissenden, le grand poète, l'esthète anarchiste qui meurt trop rapidement) ne veut reconnaître ce pour quoi il est réellement fait : écrire. Et quand la gloire arrive enfin, le spectacle de l'hypocrisie humaine finit de l'accabler. "C'étaient les bourgeois qui achetaient ses livres et remplissaient sa bourse ; or, d'après le peu qu'il savait d'eux, il lui semblait impensable qu'ils pussent apprécier ou seulement comprendre ce qu'il écrivait."
Personnage de roman lui-même (enfance difficile, génie autodidacte, bagarreur, marin, ouvrier, chercheur d'or, photographe*, écrivain à succès, etc.), il met en scène dans "Martin Eden" son double, d'abord un jeune homme un peu rustre mais qui ne manque pas de sensibilité, fasciné par la classe des gens instruits, submergé par une passion pour Ruth, une très belle jeune femme de cette bourgeoisie à laquelle il croit pouvoir accéder par l'apprentissage du savoir. Mais tout se révèle en définitive faux et illusoire, sauf certaines amitiés construites sur le partage de l'adversité ou d'une certaine notion de la beauté. L'étude compulsive des livres et son sens aigu de l'observation font rapidement de Martin Eden un révolté ; en particulier contre une société confite dans ses "valeurs établies", conduite par des sots dont le pouvoir ne repose que sur des diplômes obtenus sans intelligence, la flatterie ou une situation sociale privilégiée. Il se débat jusqu'à l'épuisement car personne (sauf Brissenden, le grand poète, l'esthète anarchiste qui meurt trop rapidement) ne veut reconnaître ce pour quoi il est réellement fait : écrire. Et quand la gloire arrive enfin, le spectacle de l'hypocrisie humaine finit de l'accabler. "C'étaient les bourgeois qui achetaient ses livres et remplissaient sa bourse ; or, d'après le peu qu'il savait d'eux, il lui semblait impensable qu'ils pussent apprécier ou seulement comprendre ce qu'il écrivait."
Martin Eden est le livre de toutes les désillusions, jusque (et surtout) vis-à-vis de l'amour, de la gloire, et même de l'écriture ; ce qui signifie en définitive, pour cet homme animé par une rage de vivre incroyable, la désillusion de la vie. Alors que Ruth revient pour le reconquérir, il ne peut lui dire que ces paroles : "Je suis un homme malade (...) Oh, pas dans mon corps. Dans mon âme, dans ma cervelle. je ne crois plus en rien. Je me moque de tout." ; et plus loin, "Je suis vidé de tout désir. S'il restait de la place dans mon cœur, je pourrais encore vouloir de vous, même aujourd'hui. Vous voyez comme je suis malade."
 "Martin Eden" est un livre immense qui devrait être, obligatoirement, au programme des lycées. Malgré son côté noir et cynique, il parle aussi de choses comme la beauté, la sensibilité, l'émotion, l'attention, la générosité, l'engagement ou le désintéressement ; autant d'antidotes possibles à la société du spectacle de Facebook et de la téléréalité.
"Martin Eden" est un livre immense qui devrait être, obligatoirement, au programme des lycées. Malgré son côté noir et cynique, il parle aussi de choses comme la beauté, la sensibilité, l'émotion, l'attention, la générosité, l'engagement ou le désintéressement ; autant d'antidotes possibles à la société du spectacle de Facebook et de la téléréalité.* Un livre superbe vient de sortir au éditions Phébus : Jack London photographe.
jeudi 10 octobre 2013
Fondation Iberê Camargo à Porto Alegre
L'homme parait assez fatigué. Il n'est plus très jeune à tout juste 80 ans. Sa silhouette est fragile. Le regard est attentif, curieux, légèrement voilé par instant : quelque chose mêlant humilité et enchantement. Ses mains tremblent imperceptiblement. Une barbe blanche que l'on devine aujourd'hui et qui, plus jeune, était évidente, parcourt son visage mince. Son nez est grand. Sa tête plutôt petite, chenue sur le sommet. Sans doute est-il surpris du nombre impressionnant de personnes venu l'écouter ce soir. C'est probablement un record pour cet espace qui accueille tant d'illustres conférenciers. Il se cale dans un fauteuil derrière une table juchée sur une petite estrade métallique. Un immense mur blanc derrière lui sur lequel seront projetées des illustrations de son travail. Il tente de prendre la mesure de la salle sur deux étages et de la foule qui l'a envahie en parcourant des yeux la semi obscurité dans laquelle baigne son auditoire compact (beaucoup de très jeunes étudiants, certains assis en tailleur au bord de l'estrade, d'autres accoudés au balcon de la mezzanine ; on a du fermer les portes avant l'heure de la conférence). Un ami le présente. Un discours lu de quelques minutes. Eloge. Puis il saisit le micro à deux mains, cale davantage son dos en arrière. Sa voix grave, chargée de la fumée des centaines de milliers de cigarettes qu'il a fumées dans son existence, est très belle. Il préférerait sans doute parler en compagnie d'une cigarette. D'ailleurs, à la fin de la conférence, l'un de ses premiers réflexes sera de sortir un paquet de sa poche , le montrer à ses hôtes avec un sourire interrogatif : on peut vraiment pas s'en griller une à présent ? Maudit règlement. Il est là pour présenter un travail qui vient de s'achever à Porto Alegre, au Brésil. Il montre d'abord des dessins un peu brouillons qui sont pour certains des impasses. Indispensables dit-il au processus de création qui n'est pas linéaire comme chacun sait, et qui peut même (doit ?) inverser les logiques. Synthèse avant analyse. Le tout puis ensuite les parties. Surtout ne pas s'enfermer trop tôt dans une idée qui se prétend aboutie, au risque de domestiquer la créativité. Et revenir dans une dynamique circulaire (il dessine des grands cercles avec ses bras). Emprunter ce chemin délicieux guidé par le hasard qui vous fait voyager autour d'un problème. Il fait des allers-retours entre la table et l'écran. Il plisse les yeux dans ses silences. Il scande des "une autre" impératifs pour passer à l'image suivante. Soudain, il s'arrête sur l'une d'entre elle et pointe une arabesque constituée de deux ou trois volutes perdues dans un dessin encore très libre, presque abstrait. Là, d'un imaginaire qu'il dit fabriqué sans méthodes de toutes ces choses vues, oubliées, accumulées, perdues, contaminées entre elles, surgit une fulgurance : l'idée originelle de ses rampes autour desquelles tout le projet pourra se déduire.
C'était un soir d'octobre 2013 (le 8 précisément) au Pavillon de l'Arsenal à Paris. Une conférence de Monsieur Alvaro Siza, immense architecte portugais.
mercredi 9 octobre 2013
mardi 8 octobre 2013
La Capitana, histoire d'une passion révolutionnaire
Mika, Micaela Feldman Etchebéhère, un nom aux accents multiples qui claque un peu comme un drapeau, et qui colle bien avec cette femme née à Moisès Ville, Argentine, en 1902, dont la vie fut entièrement consacrée à l'idéal révolutionnaire universel. Sa famille originaire de Podolie (actuelle Ukraine) avait émigré en Argentine à la fin du 19ème siècle, fuyant les persécutions à l'encontre de la communauté juive. Dès son plus jeune age elle fut donc sensibilisée à l'injustice et choisit son camp qui serait, définitivement, celui des faibles et des opprimés. A 20 ans elle est à Buenos Aires, étudiante en odontologie, participant activement à la revue d'extrême gauche Insurrexit. Le figure de Louise Michel est un modèle pour Mika. Naturellement elle soutient Trotski le banni contre Staline, ce qui lui vaut d'être exclue du parti communiste en 1925. Parce que celui qui deviendra son mari plusieurs années plus tard à Paris, Hipolito, dont elle est follement amoureuse, a besoin de repos pour soigner une tuberculose, ils partent vivre en Patagonie. Mais Hipolito, habité (dévoré) également par l'idéal révolutionnaire, se sent rapidement inutile sur ces terres du bout du monde, éloignées des lieux où l'Histoire se construit. En 1932, ils partent pour Berlin où ils vivent une courte période d'espoir dans une révolution populaire avant que la ville et le pays ne sombrent dans le nazisme. 1933, c'est le repli sur Paris qui leur offre le visage de la paix, de la beauté et de la culture. Mais un peu plus au sud, en Espagne, un conflit vient de naître entre les forces fascistes et celles de la liberté. Une fois encore, fidèles à leur convictions, ils partent et s'engagent dans le POUM. Douée d'une intelligence du combat et d'une très grande attention vis-à-vis de ses compagnons d'armes, c'est au front et dans les tranchées que Mika gagnera ses galons de capitana.
Elsa Osorio a mis plus de 25 ans pour rassembler toute la matière de ce livre et nous permettre de découvrir la vie passionnante de ce personnage de roman que fut Mika.
Deux questions peuvent se poser au terme de la lecture : peut-on faire un parallèle avec l'engagement de ces quelques jeunes français que l'on retrouve aux côtés des djihadistes, au Mali, en Libye ou en Syrie ? Comment l'opinion publique d'alors percevait-elle l'engagement de femmes comme Mika et de ces nombreux autres volontaires des Brigades Internationales, qui partaient risquer leur vie dans un pays étranger au nom d'un idéal de lutte contre le terrorisme d'état et plus d'égalité ?
Enfin, pour ceux qui ne l'aurait pas encore lu : "L'homme qui aimait les chiens" de Padura, l'histoire de Mercader, l'assassin de Trotski, prolonge magnifiquement ce récit.

samedi 5 octobre 2013
Habiter. Imaginer l'évidence. Biennale d'architecture de Caen
Caen, préfecture du Calvados, la
ville de Guillaume le Conquérant (1028-1087) dont le tombeau demeure dans le chœur de
l'abbatiale Saint-Etienne, joyau de l'art roman et gothique, merveille épargnée par
les bombes alliées, est aussi le lieu d'une biennale d'architecture qui
s'engage avec courage dans sa 3ème édition.
 |
| Façade de l'Abbatiale St Etienne |
Cette année et jusqu'au 27 octobre,
l'événement est placé sous le double signe de l'habitat et du Portugal ; ce que
traduit son titre "Habiter. Imaginons l'évidence", s'inspirant d'une
phrase du grand architecte portugais, Alvaro Siza, quand il qualifie sa
démarche de création. Deux expositions sont visibles dans le Pavillon de
Normandie - un petit bâtiment portuaire à l'architecture modeste habité du charme particulier de ces
ouvrages francs et fonctionnels - l'une présentant le travail de Paul Chemetov
sur 16 maisons et ateliers réalisées entre 1961 et 2011, l'autre une sélection
de 16 projets récents édifiés en France, chacun donnant à voir l'intelligence
constructive, urbaine ou plastique déployée à l'occasion de leur conception.
Un
film-portrait sur Siza sera présenté. La biennale fait également la part belle
aux débats avec un plateau d'intervenants de très grande qualité et pas moins
de 2 Pritzker Price (équivalent du Prix Nobel), Siza et Souto de Moura.
Enfin,
le commissaire de l'exposition est Frédéric Lenne, journaliste spécialisé en
architecture, urbanisme et politique de la ville et, de surcroit, ingénieur.
Venir pour la biennale pourrait
suffire comme prétexte pour faire le déplacement à Caen. Mais ce serait dommage
de ne pas en profiter pour découvrir une ville en grande partie reconstruite après la
2nde guerre mondiale qui recèle, malgré l'acharnement des bombes, des trésors
d'architecture. En effet, le nombre élevé d'édifices religieux remarquables -
tant par la taille que par la beauté architecturale - peut étonner le visiteur
de passage. L'Abbaye aux Hommes, et son alter ego l'Abbaye aux
Dames, constituent sans doute les deux ensembles les plus prestigieux de la
cité, au centre de laquelle veille la silhouette massive du château du
Conquérant. Mais impossible de ne pas évoquer Saint-Pierre et ses dentelles de
pierre, Saint-Sauveur du Marché et ses clés de voutes sculptées et peintes, ou les
vestiges émouvants de Saint-Etienne le Vieux.
 |
| Palais de Justice |
L'architecture civile n'est pas
en reste avec les maisons à pan-de-bois (2 remarquables fausses jumelles rue
Saint-Pierre), l'alignement d'hôtels particuliers de la rue Jean-Marot (1901), le collège Louis
Pasteur, anciennement lycée de jeunes filles, et l'élégance du dessin de sa
façade datant de 1914, avec ses motifs vernissés et ses volutes Art Nouveau, et
plus près de nous (1995) le vaisseau d'acier laqué noir du nouveau Palais de
Justice d'Architecture Studio, avec ses anneaux géométriques, le jeu
d'emboitement des volumes et du dialogue des matières, et la solennité de la
Justice reinterprétee par quatre portiques de béton brut sous lesquels
l'échine, spontanément, se courbe.
 |
| Vestige industriel |
L'avenir de la ville s'écrit en grande
partie sur la Presqu'île de Caen, vaste territoire "en devenir" de 600 ha dont la requalification a été confiée à MVRDV, une agence hollandaise. Il se construit déjà au
présent sous l'impulsion d'un maire passionné d'architecture : la médiathèque
de Rem Koolhaas (un autre hollandais) sortira de terre dans quelques semaines. Mais ce serait une erreur de ne pas
considérer les quelques bâtiments anciens qui subsistent encore sur le site. Eux seuls
peuvent apporter le supplément d'âme indispensable à un tel projet, et éviter la dérisoire collection d'architectures.
Le minuscule restaurant "Le Quai des Brumes" a évité la démolition. La minoterie toute proche devrait être sauvée. Mais ce n'est pas le cas, semble-t-il, des hangars
en bois dénommés Pavillon Savare,
 |
| Façade bois du Pavillon Savare |
qui jouxtent la future médiathèque. La composition de leurs façades en lattis bois ou dans une association de briques et de bois, leur charpente exprimant vérité constructive et frugalité, dégagent une émotion évidente. Ces lieux ont une âme. Ils
abritent aujourd'hui une association de restauration de vieux bateaux, Le
Conservatoire de la navigation. Des passionnés qui croient encore aux vertus de la mémoire ; et du lien social puisqu'ils accueillent des personnes en réinsertion.
 |
| Bâteau en cours de restauration. Pavillon Savare |
Le bâti - structure et façades bois - est
en très mauvais état et, parait-il, rongé par les vers. Mais on maitrise aujourd'hui
les techniques permettant à la fois de juguler les xylophages, et de rétablir
la solidité structurelle. Bien entendu, il faudrait investir pour sauvegarder
ce patrimoine. Il serait plus facile et rentable (à court terme) de tout raser
et de vendre des droits à construire. Mais ce dont a besoin la ville moderne c'est
de "coutures", de mémoire autant que de modernité, d'une mixité culturelle dans
laquelle le dialogue entre l'ancien et le neuf constitue un liant précieux et vital. "La
modernité a un cœur ancien", nous dit Renzo Piano. Caen doit s'inspirer de Nantes avec
laquelle elle a de nombreux points communs (un passé industriel prestigieux, un
positionnement "marin", des traces d'une activité humaine riche d'humanité, etc.). Il est raisonnable d'être optimiste.
 |
| Façade Librairie Générale du Calvados |
 |
| L'Albatros, vaste oiseau des mers |
Ajouté à ça que Caen est une ville
forcement sympathique : les tripes y sont délicieuses (Brasserie Le Carlotta), et il y subsiste encore plusieurs librairies indépendantes, dont la magnifique Librairie générale du
Calvados (superbe façade bois de 1902) et son albatros aux ailes de géant suspendu au plafond.
Inscription à :
Articles (Atom)